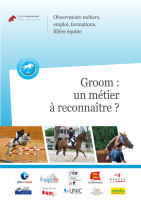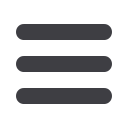

45
Conclusion : le métier de groom : une nécessaire reconnaissance ?
L’implication d’un groupe de travail dédié constitué d’experts (juristes, chercheurs, conseillers…) et de
représentants (employeurs, grooms, socio-professionnels...) est nécessaire. Utiliser des méthodes de mobi-
lisation, d’animation et d’accompagnement pour une action collective, promouvoir le dialogue le sont
également. Afin d’aboutir à la reconnaissance d’un métier, ce groupe de travail pourrait définir diffé-
rentes pistes de réalisations et de travaux :
ß
ß
Établissement d’un référentiel de compétences (une « charte » des grooms) et création d’une fiche
métier spécifique (missions, cadre d’exercice, référentiel d’activités, de compétences et de forma-
tion…) en s’appuyant sur les études publiées et différents audits d’employeurs et de grooms ;
L’objectif est d’aboutir à une définition stabilisée permettant de faire reconnaître ce métier dans la
nomenclature INSEE (code APE : Activité Principale Exercée) et dans les répertoires nationaux tels que
le Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME). Chaque fiche métier est composée outre
du code et de l’intitulé de la fiche ROME, des appellations correspondantes, de la définition du métier,
des conditions d’accès au métier, des conditions d’exercice de l’activité, des savoir-faire et savoirs, des
environnements de travail et d’une rubrique « Mobilité professionnelle » permettant d’identifier les métiers
accessibles facilement et les métiers envisageables avec une adaptation ou une formation.
ß
ß
Identification des besoins en personnel actuels et à venir ;
ß
ß
Étude de parcours professionnels ;
ß
ß
Prise de contact et échange avec des représentants d’organismes compétents en matière de
construction des métiers et des cadres d’emplois (MSA, l’INSEE, Pôle emploi, Ministère de l’intérieur,
organismes de formation...)
Selon les avancées certaines du secteur, la création d’une convention « sport » pourrait traiter notam-
ment du métier de groom (grille de salaire, définition des compétences…) sur le modèle du garçon de
voyage ‘Convention collective nationale de travail » concernant les établissements d’entraînement de
chevaux de courses au galop 20 décembre 1990) ou du trot (9 janvier 1979). Accords officiels conclus
le plus souvent entre les organisations patronales et les représentants des salariés, les conventions col-
lectives ont l’avantage d’adapter les dispositions générales du Code du travail aux spécificités et aux
contraintes d’un secteur précis, contraintes nombreuses pour le secteur du sport. Elles traitent égale-
ment de tous les thèmes : salaires, classifications, congés, conditions de travail… Elles peuvent également
encadrer la formation professionnelle.
Au-delà de l’amélioration des conditions de travail, reconnaître un métier permet aussi son analyse et la
diffusion de statistiques. Par exemple, connaître le nombre de grooms en exercice permettrait d’estimer
les besoins en recrutement et ainsi réguler les offres de formations et le nombre de places proposées tout
en adaptant les champs de compétences aux besoins des professionnels (compétences spécifiques et
transversales). Cela permet d’engager une réflexion sur les évolutions prospectives du métier et en anti-
ciper les mutations économiques.
*****
Cette étude pose un certain nombre d’interrogations et de pistes de travail. Contrairement aux acteurs
traditionnels de la filière équine, il semble que les grooms aient légitimé leur statut et leur rôle au fur et à
mesure de leur action et de la structuration du milieu. De ce fait, quels sont donc aujourd’hui les enjeux
de leur reconnaissance et de leur professionnalisation ? La reconnaissance par les pairs, accompagnée
de la mise en place de formations en voie de certification peuvent-elles aboutir à une reconnaissance
totale ? Comment mettre en visibilité la réalité et par là-même une reconnaissance des compétences
des grooms ? Comment passer d’un métier trop souvent caractérisé par sa précarité et sa dureté et
en faire une profession « instituée » avec un statut consolidé ? Enfin, accorder aux grooms une place
institutionnelle clairement identifiée leur permettrait-il de sortir d’une forme de précarité ressentie dans
l’exercice de leur activité ? En d’autres termes, le métier de groom doit-il être reconnu comme un métier
à part entière au même titre que le soigneur et le cavalier soigneur ?
Il est certain que la professionnalisation du métier de groom permettrait de garantir la qualité de leur
quotidien, renforcer les compétences à maîtriser, les situer par rapport aux institutionnels, professionnels
et autres travailleurs en reconnaissant la spécificité de chacun et leur permettre d’évoluer professionnel-
lement. Cela pourrait ainsi institutionnaliser, faire reconnaître et partager leur expertise.
Les temps de repos sont rares, il faut savoir en profiter.